
« Extimité » ce sont des conversations entre personnes minorisées qu’il faut écouter en cas de blues. A l’heure où les violences policières ou les discours xénophobes sont banalisés sur les plateaux tv et les réseaux sociaux, il n’est jamais facile d’être. Quand on est dans une minorité et qu’on nous le rappelle sans cesse par une remarque, un geste ou un regard de travers, les témoignages des invités font un bien fou ! Car ils font écho à notre propre histoire, qui nous rappellent que nous ne sommes pas seul.e.s à vivre ces choses-là : où on est resté sans voix pendant le repas familial quand l’oncle relou nous a rabaissé au sexe faible ou au titre de « pédale ». Ou encore cette fois où on s’est tu quand un ami nous a réduit à notre race de « bridé », de « négro » pour déconner en soirée, ou bien quand on a été infantilisé à cause de son handicap.
Avec plus de 20 000 écoutes par épisode, « Extimité » rend visible certains aspects de soi jusque-là considérés comme relevant de l’intimité par pudeur ou par honte ? Ce podcast bimensuel redonne la paroles aux invisibilisé.e.s dont les trajectoires considérées comme peu importante par le mainstream et la norme. Lancé par Douce Dibondo et Anthony Vincent, journalistes revendiquant une identité queer et racisée, « Extimité » lève le voile sur les différentes oppressions systémiques que vivent leurs invités. Leur récits racontent les conflits, la violence ordinaires auxquels ils ont été confrontés, liés aux rapports de domination découlant des valeurs néocolonialistes et patriarcales.
J’ai voulu poser quelques questions à ces deux journalistes qui militent au quotidien au sein de rédactions pour faire entendre d’autres points de vue.
Prendre conscience…
Bonjour Douce et Anthony. Le principe de l’émission est de mettre en avant les portraits de personnes minorisées et leur cheminement vers la déconstruction. Pouvez-vous expliquer qui sont vos invités et à qui s’adresse votre podcast ?
Douce : Pour moi, Extimité s’adresse d’abord aux personnes concernées qui ont besoin de se reconnaître et de ne plus se sentir seules face à ces situations de discriminations latentes ou plus directes avec lesquelles on compose au quotidien. Toutefois, s’il y a des personnes qui ne sont pas concernées directement mais qui apprennent de ces récits c’est très bien ! On aura évité des heures et des heures de pédagogie en apéro ou devant la machine à café. En tout cas, il est important que les “je” qui se racontent dans « Extimité » résonnent de manière universelle.
Anthony : Là encore, cela peut paraître paradoxal de penser que le cas particulier d’une femme transgenre, racisée, travailleuse du sexe puisse parler au plus grand nombre. Pourtant, c’est justement parce qu’elle cumule les oppressions que son expérience du monde s’en trouve élargie, et donc son analyse de la société affûtée et pertinente. Les médias mainstream veulent nous faire croire que des éditorialistes qui n’ont vécu que dans le 16e arrondissement de Paris ont un avis pertinent sur tous les sujets, les magazines féminins que les ¾ des femmes sont blondes, grandes et minces, et les séries TV que seule la vie des médecins et des avocats valent la peine d’être racontées. Parfois, on a le droit à 3 films misérabilistes par an sur la vie d’une personne handicapée, LGBT+, ou racisée, mais attention, faut choisir, afin de bien rentrer dans une case prête-à-penser. Pour Extimité, on ne fait pas d’efforts de casting de “qui cumule le plus d’oppressions”, on se demande juste : “Qui est-ce qu’on n’a pas encore entendu ? Qui est réduit au silence ?” Et ça fait un sacré paquet de monde qui veut parler, parle même déjà, et ne demande qu’à être écouté, en fait. Et vu combien notre audience se montre réceptive à ces récits de la vraie vie, cela prouve bien qu’on en avait tou.te.s besoin.
Pour les enfants d’immigrés, l’estime de soi n’est pas un concept de livre de développement personnel, mais bien un outil de survie essentiel.
Qu’est-ce ce que la déconstruction pour vous ?
Douce : Vaste question sur la déconstruction… Alors déjà le déconstructivisme est une notion que le philosophe algérien Jacques Derrida remet au goût du jour dans sa manière d’analyser puis de concevoir la littérature. Dans un texte qu’est-ce que dit le vide, le non sens, les omissions, les fautes, les ellipses etc. Voir et décortiquer entre les mots et les phrases. Et cette notion de déconstruction va avoir un écho plus fort aux Etats-Unis où il a toujours été reconnu et adulé par l’intelligentsia états-unienne. En rencontrant la notion sociologique de constructivisme (tout est une construction sociale), ça a eu une résonnance dans les sciences sociales avec les race et gender-studies, puis en toute logique dans le militantisme. De manière plus personnelle, déconstruire c’est se décentrer et regarder où l’on se situe sur le grand échiquier social. Quels désavantages, quels privilèges ? Puis de revenir à soi et regarder les mécanismes qui font marcher ce grand théâtre social : quels sont les codes, les enjeux de pouvoir, qui est assigné à être minoritaire, qui ne se désigne jamais comme majoritaire, quel poids historique nous conditionne, quels imaginaires et formes-pensées conduisent à des schémas répétitifs de la société ? Et ce à tous les niveaux… Bref la déconstruction c’est un travail permanent sur soi qui a un but collectif, déconstruire la société.
Anthony : Se déconstruire, c’est un processus de réflexion sans fin qui consiste à se demander d’où viennent nos préférences et nos croyances. Et c’est tout à fait humain d’en avoir, le but n’est pas forcément de les éliminer. Mais plutôt d’admettre qu’on a parfois certains conditionnements et biais qui font qu’on préfère certaines choses plutôt que d’autres. Et ce n’est pas parce qu’on se demande “pourquoi ?” qu’on tombe dans le jugement moral et catégorique. Au contraire, même.
Se raconter : une catharsis collective

Vous avez commencé le podcast en racontant vos propres histoires et intimité à l’épisode 0 et 1. Ce n’est pas un exercice courant pour des journalistes. En quoi était-ce important pour vous de vous mettre à nu en premier ?
Douce : Pour ma part, il était important de me placer de manière horizontale face aux auditeurices et aux futur.e.s invité.e.s. Il fallait donner l’exemple. Comme dans toutes relations, il s’agit de respecter un équilibre entre le don et le contre-don. Je ne me voyais pas prendre quelque chose de nos invité.e.s sans jamais me dévoiler et me situer. Car avant d’être une journaliste indépendante, je suis d’abord cette femme congolaise, noire, bi et queer qui se reconnaît dans les vécus à la marge de la majorité. Et pour ne plus se comparer à cette dernière, ma parole devait s’entendre pleinement en tant que “je”.
Anthony : En plus d’être contre-intuitif, raconter publiquement mon intimité me semblait aller à l’encontre de ce qu’on nous répète en étude de journalisme : “le je est haïssable.” Les journalistes se dévoilent peu, par souci de paraître le plus objectif possible. Or, je pense qu’on s’approche beaucoup plus de l’idéal qu’est l’objectivité journalistique quand on admet ses biais, ses failles, ses origines et ses désirs. Ces premiers épisodes reviennent donc à signer une sorte de pacte de lecture avec notre audience : admettre que tout point de vue est situé, y compris ceux de journalistes comme Douce et moi, et que nos subjectivités teinteraient forcément un peu les futurs épisodes. C’est une manière de se montrer radicalement honnêtes, en plus de se placer à égalité avec nos invité.e.s et l’audience.
En France la classe avant la race c’est le slogan de la gauche qui aurait pu se déconstruire et voir son racisme latent en pleine face. Il est plus facile de parler de quartiers et de personnes “défavorisées” sans parler de personnes favorisées.
A partir de quand avez-vous réalisé que vous n’étiez pas blanc.he.s et pourriez-vous identifier votre prise de conscience du racisme systémique et des mouvements décoloniaux ?
Douce : Clairement, je l’ai réalisé quand j’ai débarqué en France à 12 ans. En partant du Congo je savais que j’avais la peau noire, mais je ne me disais pas noire. En France j’ai été la blédarde, la bounty, la “fatou fachée” etc. Mais ce n’est que pendant mes études de sociologie, en deuxième année de licence, à 18 ans que j’ai commencé à déconstruire toutes les fausses croyances sociales que la France avait bien eu le temps de me faire avaler… Pour les mouvements décoloniaux l’un des évènement clés c’est la mort d’Adama Traoré qui a fait écho à la mort de Zyed et Bouna en 2005, année où je suis arrivée en France. Je me souviens que j’étais en banlieue en Essonne et je voyais les quartiers s’embraser, ma cousine partant avec ses amies en manif sauvage face aux flics. Tout ça m’est revenu en mémoire et le puzzle a commencé à se rassembler, naturellement.
Anthony : J’ai grandi dans une famille qui m’a fait comprendre très tôt que j’étais noir, mais elle m’a inculqué au passage des principes coloristes (N.D.A : favoriser les personnes qui ont la peau clair et dévaloriser celles qui ont la peau plus foncée dans la société) que j’ai intégrés et reproduits sans les interroger, jusqu’à ce que j’arrive à l’âge adulte. En grandissant en banlieue populaire, parce que je n’ai jamais été le plus foncé, j’ai bénéficié de certains privilèges qui m’ont laissé croire que j’étais épargné par le racisme. Mais au fil de mes études supérieures jusqu’à arriver dans le milieu professionnel, je croisais de moins en moins de personnes racisées. C’est en enchaînant les visites d’appartements infructueuses, les contrôles de police, et les dates avec des fétichistes que j’ai réalisé que j’étais perçu comme un homme noir avant tout, peu importe mon niveau d’éducation, de présentation, ou de mélanine. C’est donc vers 21-22 ans que j’ai ouvert les yeux progressivement sur le racisme que je subissais, mais aussi que je perpétuais sans m’en rendre compte. Et l’injustice autour de la mort d’Adama Traoré m’a convaincu de m’engager davantage contre tous ces préjugés.
Quels sont les étiquettes et stigmas qu’on vous colle et qui vous énervent ? Avez-vous réussi à les accepter, ou à vous en débarrasser ? Quelles sont celles que vous vous réappropriez aujourd’hui s’il y en a ?

Douce : J’ai tellement réussi à décortiquer les mécanismes et les stigmatisations qui me sont renvoyées en tant que femme noire et plus récemment en tant que meuf bi que je ne m’enerve pas. Avant la colère venait de cette impossibilité à expliquer mon malaise, à expliquer pourquoi je n’avais pas à subir les remarques mysoginoiristes et biphobes. Depuis ma déconstruction, les stigmas, je les balaie et je renvoie à l’envoyeur ses discriminations, sans pour autant perdre mon énergie à justifier mon humanité. Oui, je suis noire, africaine et fière, oui je suis queer et fière, oui je suis spirituelle et fière. J’embrasse tout de moi, donc je me réapproprie mon être. Je ne me débarrasse de rien, je transforme tout.
Anthony : Physiquement, je corresponds au stéréotype de la folle noire bitchy et fan de mode, adorée par les télé-réalités. J’ai longtemps lutté contre ça, la follophobie s’ajoutant à l’homophobie et au racisme que j’avais déjà bien intériorisés. Mais à mesure que j’en apprenais sur le féminisme, j’ai compris combien ce cliché tirait de la misogynie. Quand je lisais des choses sur le stéréotype de l’angry black woman en particulier, je pouvais en tirer énormément d’enseignements sur comment j’étais perçu en société. Alors aujourd’hui, je ne me défends plus de cette part de moi, je l’embrasse, et je suis même fier d’être flamboyant.
L’autre : le miroir de soi
Quelles expériences ou réflexions décrites a fait le plus écho en vous depuis le début du podcast?
Douce : Dans la saison 1 j’ai été touchée par le récit de Sun, une meuf queer ayant fui son pays en guerre (ce qu’en Occident nous avons romantisé en Printemps arabe). “C’est puissant de partir, c’est puissant de rester” dit Sun. Et forcément en tant qu’exilée ça a résonné fort en moi. Elle a cette résilience et cette abnégation de la douleur que les personnes exilées portent malgré elles. Dans la saison 2, j’ai adoré les récits de Thérèse, chanteuse bie, asiatique et c’est le vécu de Wolky, homme noir gay, médecin, qui appuie où ça fait du bien. Elle, pour sa vie si équilibrée de l’amour et de la conscience de soi, son humilité face à ses failles et sa soif de liberté accrue, malgré les carcans sociaux qui tentent de nous enfermer toujours plus. Lui, pour la conscience qu’il avait de son monde intérieur, la distance qu’il est parvenu à mettre face à sa hiérarchie professionnelle raciste, tout le travail émotionnel effectué sur lui, sa vision de l’amour et des relations… Ce sont des miroirs plus ou moins recollés de ma propre histoire. C’est égoïstement collectif : en tant que vécu marginal, je place les mis.e.s à l’écart au centre de mon monde, donc du monde. Et j’espère que nos auditeurices vivent aussi la même expérience à travers le podcast.

Anthony : Chaque invité.e nous a énormément appris sur la société et ses structures. En ce qui concerne les récits qui ont le plus fait écho en moi personnellement, celui de Paul-Arthur me vient en premier car nous nous ressemblons beaucoup socialement : hommes noirs, gays, cisgenres, journalistes modes à Paris. Celui de Paya aussi, notamment parce qu’elle a répondu à une question que je commençais à peine à effleurer sur la fatigue militante. On ne peut rendre service à sa cause sur le long terme s’y l’on s’y épuise, alors c’est important de se reposer, voire de prendre ses distances un temps. Le repos sert aussi la lutte. Il en fait même partie intégrante. Je pense aussi à Marie-Odile, quand elle raconte comment sa mère afrobrésilienne a tenté de la blanchir durant toute son enfance parce qu’elle a elle-même grandi dans une société pigmentocratique. Et comment l’art l’aide à se réconcilier avec ses origines aujourd’hui.
Raconter l’intimité est au coeur de votre podcast et des « gender and ethnic studies« qui mettent en avant les récits de vie. Quels penseur.se.s, artistes ou modèles vous inspirent le plus ?
Douce : Mes inspirations… Je puise beaucoup de force auprès de Rokhaya Diallo, Amandine Gay, Fania Noël et bien d’autres qui incarnent les luttes antiraciste et afroféministe contemporaines. Mon cerveau est nourri aussi par les penseuses comme Audre Lorde, Bell Hooks, Toni Morrison, Monique Wittig, Françoise Héritier, Elsa Dorlin… En terme artistique j’ai un coup de coeur pour Yseult et Lous and The Yakuza, mon regard est de plus en plus tourné vers l’Afrique et les talents créatifs qu’elle voit de plus en plus émerger en musique, en art, en culture tels que Ibaaku, Jojo Abot, L’artrepreneur, Lafalaise Dion, Kente Gentleman et bien d’autres que j’oublie !
Anthony : En plus des autrices afroféministes citées par Douce, m’ont inspiré Roxane Gay, Susan Sontag, Virginie Despentes, Mona Chollet, Paul B. Préciado et Frantz Fanon. Ado, je me réfugiais dans les pages d’Hervé Guibert, James Baldwin, et Didier Eribon, que j’ai vraiment lus comme des phares pour survivre. Aujourd’hui, je suis de près le travail du dramaturge Jeremy O. Harris, du poète Ocean Vuong, et de l’artiste FKA Twigs.
Etre à l’écoute et changer les rapports de force
Vous demandez à chaque épisode si vos invité.e.s se sont déjà sentis dominants, alors qu’ils parlent de leur expérience de personnes minorisées, pourquoi cette question ?
Douce : Encore cette idée de déplacer le curseur. Comment les personnes qui sont assignées à la marginalité, se perçoivent et vivent cette assignation. Et parfois selon les réponses, on se rend bien compte que c’est souvent dans la non-mixité, entouré.e.s de personnes qui les ressemblent que les invité.e.s se sentent majoritaires. Il y a une puissance à se réapproprier les mots, les espaces et les manières de nous penser, entre nous, avec nous. Ce n’est pas subi, c’est revendiqué !
Anthony : Cette question représente aussi une occasion de se demander si, dans l’entrecroisement des différentes oppressions en fonction des contextes, on n’a pas déjà été en position de dominant.e. Je crois que c’est en enregistrant mon propre épisode d’Extimité que j’ai pris conscience de combien j’avais pu intérioriser le racisme et l’homophobie afin de me rapprocher de la majorité et sa domination par le passé.
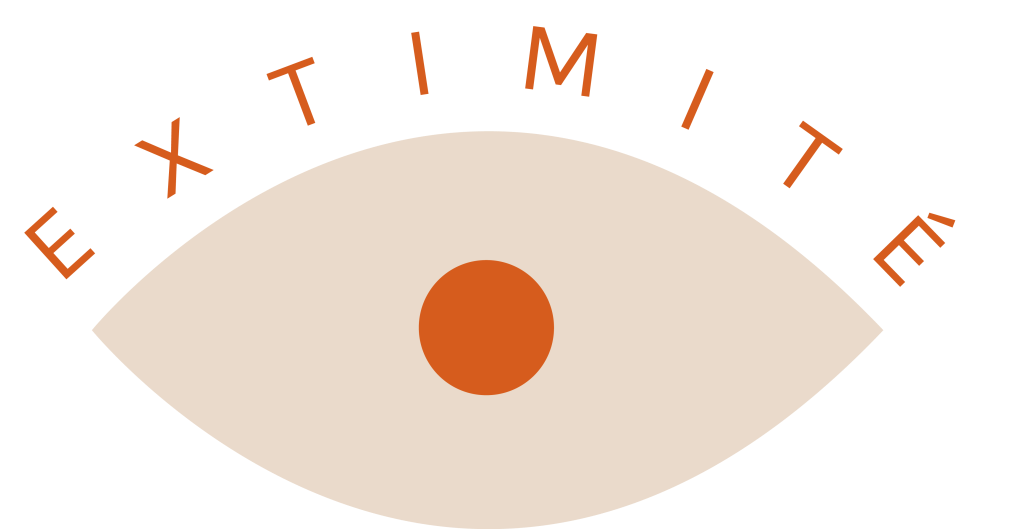
On parle de plus en plus de racisme anti-blanc et d’appropriation culturelle dans les médias et ça suscite beaucoup de craintes auprès des classes dominantes blanches, même au sein de mouvements féministes. Pourquoi à l’heure du covid-19 il est facile de se dire privilégié socialement et d’avouer les inégalités sociales alors qu’il est impossible d’avouer son privilège blanc selon vous ?
Douce : Parce qu’en France la classe avant la race c’est le slogan de la gauche qui aurait pu se déconstruire et voir son racisme latent en pleine face. Il est plus facile de parler de quartiers et de personnes “défavorisées” sans parler de personnes favorisées. Mais qui sont ces personnes défavorisées, qui n’ont jamais de visage, jamais de nom en France ? Il est plus confortable d’envelopper les inégalités du voile économique sans jamais expliquer que le facteur économique est intrinsèquement lié au racisme de la société française et dans toutes ses institutions. En France on loue Pierre Bourdieu pour la notion de reproduction des inégalités mais on réfute aveuglément de la pousser. On n’adule pas un Pape Ndiaye qui met en lumière La condition noire et ce qu’elle implique en terme socio-économique. La France continue ainsi à reproduire les classes des favorisés et des “défavorisés”.
Anthony : Globalement en France, l’assimilation est pensée comme un modèle à atteindre, ce qui explique notamment les crispations dès qu’on parle de communautarisme, de non-mixité, ou qu’on désigne des couleurs de peau. Cela empêche aussi de penser de façon structurelle, et donc de considérer qu’être blanc soit un privilège. Quand elles sont désignées comme un groupe social, les personnes blanches peuvent être prompts à crier à l’essentialisation et au racisme, justement parce qu’elles n’ont pas l’habitude de se penser comme telle. Elles n’ont jamais eu à se réfléchir comme telle parce qu’elles ont toujours bénéficié de cette ignorance. C’est le comble du privilège blanc. Et c’est aussi ce qui explique la fragilité blanche allant avec quand on les désigne comme tel : c’est inconfortable à admettre. Alors elles se braquent et racontent qu’on les a traitées de cachet d’aspirine à la récré, qu’elles ont eu un job étudiant comme tout le monde, que leurs parents étaient pauvres ou qu’elles ont failli être SDF, incapables de vouloir comprendre qu’on leur parle de violences structurelles. Incapables de vouloir comprendre que le privilège blanc veut seulement dire que leur couleur de peau n’a jamais été un frein dans leur vie. Contrairement aux personnes racisées. La géographe Ruth Gilmore définit le racisme comme ce qui expose à la mort prématurément. Le COVID-19 et les violences policières démultipliées en cette période de confinement en sont des preuves supplémentaires.

L’extimité a un rapport avec l’estime de soi. Comment selon vous, valoriser cela en tant qu’enfants d’immigrés ?
Douce : C’est un chemin qu’on n’a pas le choix d’emprunter. L’estime de soi en tant que personnes racisée est une obligation de survie face à une société qui ne nous voit pas et donc ne nous reconnaît pas, car nous ne sommes pas à son image. Il faut donc se créer une image face au miroir. Je brise le besoin de reconnaissance oedipien et je me reconnais par mes propres lunettes. Celles qui forgent ma déconstruction et ma reconstruction sur tous les plans de conscience (physique, émotionnel, intellectuel et spirituel).
Anthony : Audre Lorde écrivait justement combien prendre soin de soi ne tient pas de l’indulgence vaine, mais bien de l’auto-préservation, et que c’est un acte politique pour les personnes minorisées. Pour les enfants d’immigrés, l’estime de soi n’est pas un concept de livre de développement personnel, mais bien un outil de survie essentiel. Ou plutôt une fondation sur laquelle se construire. Sans elle, vous aurez beau en faire 4 fois plus que les autres et collectionner les diplômes, le syndrome de l’imposteur sera toujours là pour vous empêcher de croire en vous-même.

Quels podcasts écoutez-vous et pourriez-vous en recommander à ce sujet ?
Douce : « Furies », « What the F* podcast »,« Still processing » (anglophone), « Code Switch« , « Busy Being Black« , « La Fièvre », « Les enfants du bruit et de l’odeur », « Piment« … Qui parlent des identités plurielles qui me constituent, femme, noire et queer.
Anthony : “Food 4 Thot” qui est l’incarnation du podcast dont je n’osais même pas rêver, hilarant et érudit, tenu par 4 personnes queer et racisées qui parlent de culture, de société, de genres et de sexualités. “Un podcast à soi” sur les enjeux féministes. “La Poudre” des conversations avec des femmes inspirantes.
“Caring for myself is not self-indulgence, it is self-preservation, and that is an act of political warfare.”
— Audre Lorde dans « A Burst of Light ».
Extimité c’est donc un objet d’empowerment puissant et un tiers-lieu d’écoute et de partage qui encourage les invisibilisés à se raconter petit à petit – fièrement, en valorisant leur vécu – sans que leur témoignages soient déformés ou dévalorisés par l’Histoire ou les médias…
Le travail de Douce et Anthony a été récompensé par le Bondy Blog pour l’égalité des chances et contre les discriminations en 2019, car il recèle de grandes sagesses et une lucidité sur le monde, tel que vous ne l’aviez jamais vu.
Si vous souhaitez une saison 3 vous pouvez tipser à https://fr.tipeee.com/extimite pour les aider à produire ce podcast 100% indépendant. Parce que les journalistes et les artistes sont trop peu rémunérés pour leur juste valeur et surtout pour contribuer à cet effort de représentation et d’inclusion des minorités dans les films, les peintures, la littérature et les médias. Pour que chaque histoire ne relève plus de l’anecdote mais bien de l’histoire collective.
Retrouvez « Extimité » sur toutes les plateformes de streaming dont apple podcast.
Un commentaire sur “Extimité, le podcast : rendre visible l’invisible”